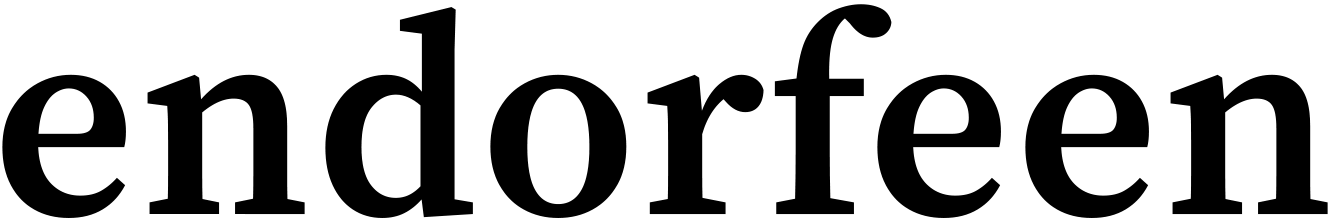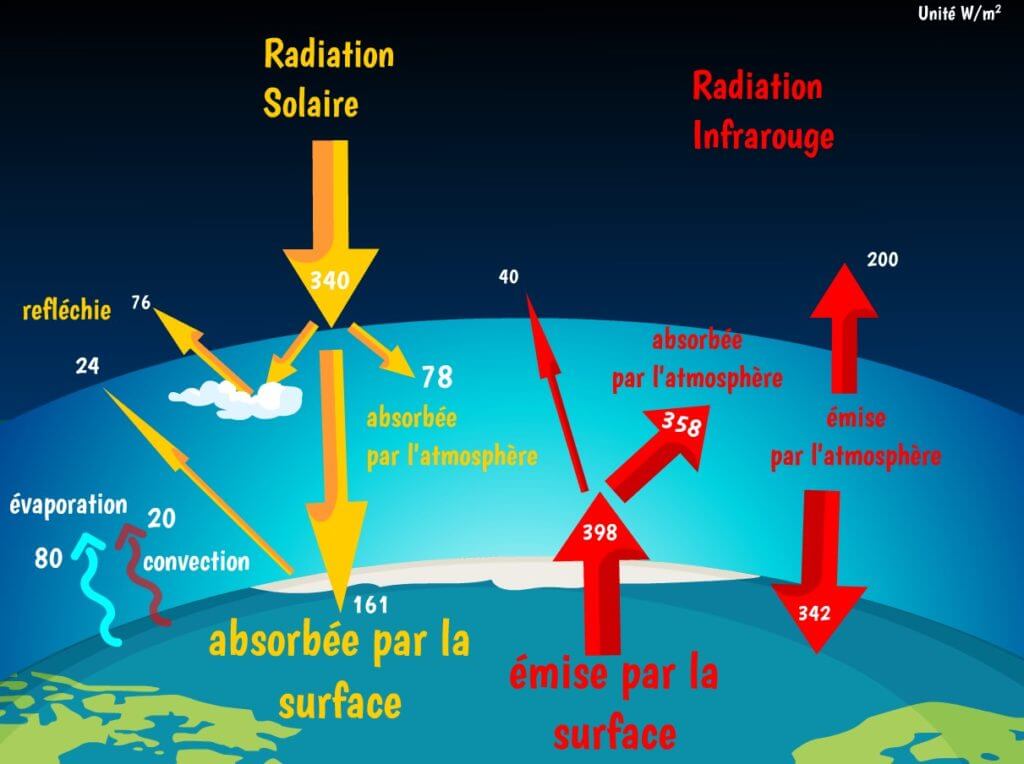Tête de la Muraillette, ou comment échapper à la chaleur.
La France est en train de vivre ses journées les plus chaudes jamais enregistrées, sûrement encore plus chaudes que celles de la canicule de 2003 : plus de 40 degrés dans le Bordelais, à Nantes, dans la Vallée du Rhône et même en Bretagne ! Alors qu’une grande partie de l’Europe occidentale suffoque, partir en montagne pour trouver de la fraicheur devient presque une nécessité. En effet, la cuvette grenobloise n’est pas épargnée, la barre des 40°C ayant été atteinte ce mardi 19 juillet, avec un ressenti de 46°C.
Aller à 1000m ? C’est 34°C qui vous attendront.
Aller à 1500m ? Vous cuirez tout autant.
Les Ecrins et la Tête de la Muraillette
Seule solution, passer la barre des 2000m et s’échapper des massifs entourant la métropole de Grenoble. C’est là que le Massif des Ecrins devient une porte de sortie intéressante pour fuir le sauna des plaines. Des forêts, de l’eau, de l’air et de l’altitude, le mélange idéal pour diviser par deux les litres de transpiration et dormir sereinement le temps d’une nuit en haute montagne. Et quoi de mieux qu’un itinéraire reliant deux des plus beaux lacs du Massif des Ecrins ? C’est ce que je vous propose avec l’ascension de la Tête de la Muraillette 3019m, un des premiers 3000 du massif en partant du Nord-Ouest, entouré par le Lac de la Muzelle et le Lauvitel.
Ce sommet me narguait depuis quelques temps puisqu’une ascension a été tentée à l’automne 2019 mais empêchée par la neige qui s’était invité dès 2000m. Cette fois c’est la bonne, plus de neige, même plus de glacier, que du caillou !
Ce circuit d’environ 25km peut se réaliser en une seule journée, mais dans le but de profiter de la fraicheur des cimes, une nuit sera réalisée à mi-parcours, l’occasion de profiter du coucher et du lever du soleil sur le Massif des Ecrins.
Savoir prendre son temps
L’itinéraire sera effectué dans le sens Muzelle puis Lauvitel, mais il est tout à fait concevable de le réaliser en sens inverse. De plus, le bivouac sera monté au niveau du Col du Vallon, bien entendu il peut être installé soit au Lac de la Muzelle soit au Lauvitel, bien que le terrain soit assez restreint autour de ce dernier. Néanmoins, un bivouac au col a pour avantage de couper la randonnée en deux parties globalement égales. De plus, il s’agit du point le plus haut, un peu plus de 2500m, où une tente peut être installée, le sentier menant à la Tête de la Muraillette empruntant par la suite pierriers et arêtes. Ainsi, on pourra profiter d’un maximum de fraicheur.
Pour débuter la randonnée, il faut se rendre dans la Vallée du Vénéon qui s’enfonce vers le coeur du Massif des Ecrins, en direction du village de la Bérarde. Après le petit village de Vénosc, il faut se garer au parking juste avant le hameau de l’Alleau. Situé à 900m, la chaleur est encore étouffante et même si on débute en sous-bois et en longeant un torrent, la liquéfaction n’est pas très loin. Quelle bonne idée un départ à la mi-journée !

Quelques minutes après le départ, on peut bifurquer légèrement du sentier principal pour se rendre près de la Cascade de la Muzelle. Mais c’est un cul-de-sac, il faut bien revenir sur ses pas pour reprendre le fil de l’ascension.

La montée
On commence à bien surplomber la Vallée du Vénéon dès les premiers quarts d’heure. Il faut dire que la première partie de la montée vers le Lac de la Muzelle est assez rude, surtout sous cette chaleur.


On met rapidement pied dans le coeur du Parc National des Ecrins. Les petits drapeaux tricolores indiquant les délimitations de l’espace protégé.

Avec la chaleur, les gourdes sont vite à sec. Le joliment nommé Ruisseau de la Pisse, coulant au fond du Vallon de la Muzelle, permet un ravitaillement en eau à de nombreux moments lors de l’ascension.

Une fois sorti de la forêt, la pente s’adoucit jusqu’au Cirque du Clot du Selat fermant le vallon. Au-dessus du cirque, l’objectif du lendemain : la Tête de la Muraillette.

A la recherche de la fraicheur, les moutons ont pris d’assaut ce petit mont.


Après le vallon, la pente repart de plus belle. Les cimes des Grandes-Rousses apparaissent dans notre dos, puis c’est au tour de la station des Deux Alpes.

Derrière une arête, la reine des lieux se dresse avec son glacier suspendu : la Roche de la Muzelle 3465m

Quelques sommets des Ecrins sortent également de l’arête comme le Râteau 3809m et l’Aiguille du Plat de la Selle 3596m.

Peu avant le Refuge de la Muzelle, au niveau des tourbières, quelques ânes et mulets paissent dans l’alpage. Sûrement des compagnons de sortie pour les amateurs de treks organisés.

Avec le Pic du Mas de la Grave 3020m en toile de fond.

Quelques nuages flirtent avec les sommets, laissant par moment les rayons du soleil frapper par-ci par-là les parois des Ecrins.
Vers le bivouac sur notre itinéraire de la Tête de la Muraillette

Arrivée au Lac de la Muzelle 2105m entouré de ses trois pics : la Roche de la Muzelle à gauche, le Pic du Clapier du Peyron et la Tête de la Muraillette à droite. Au centre, le Col de la Muzelle.
Une fois au lac, on peut directement se diriger vers le Col du Vallon, lieu d’installation pour le bivouac. Mais ce serait dommage de ne pas partir sur les hauteurs du Refuge de la Muzelle pour le belvédère sur le lac et les merveilles géologiques qui s’y cachent.

On prend donc la direction de la voie normale de l’ascension de la Roche de la Muzelle. Sur 500m de dénivelés, le sentier est totalement randonnable. Le sommet n’est pas indiqué sur les panneaux, il faut suivre la Roche Percée.

Premier piton rocheux au dessus du lac.
On passe rapidement les arches, le soleil n’étant pas au rendez-vous. Le paysage sera plus spectaculaire à la descente, quand les nuages se seront dissipés au dessus de la Muzelle. On se content pour le moment d’étonnants reflets sur les eaux du lac.

La cime de la Tête de la Muraillette et une partie du ciel se reflètent merveilleusement bien dans le Lac de la Muzelle.

Avec le Refuge cette fois-ci.


Sans et avec les rayons du soleil.

Tête de la Muraillette et Lac de la Muzelle.


Le Refuge de la Muzelle et l’alimentation du lac par le Ruisseau des Cabanes. C’est de ce côté du lac que le bivouac est autorisé.


Une première arche surplombant le lac, sur les cartes elle se nomme »la cheminée de fée ». Il est possible de se rendre au coeur du rocher pour s’immortaliser le temps d’un instant.
En prenant de la hauteur
Après l’arche, on peut encore continuer la montée afin de se rapprocher du Glacier de la Muzelle et d’agrandir le panorama au-delà du Cirque éponyme.

Entre Grandes-Rousses, Arves et Ecrins.

La Pointe de Malhaubert et le Rochail se dévoilent derrière le Col du Vallon à gauche. Au centre, les Trois Pics de Belledonne apparaissent à côté de l’Aiguille de Vénosc.



Front glaciaire et falaise Ouest.


Au delà de ces pentes herbeuses, le sentier d’alpinisme débute pour l’ascension de la Roche de la Muzelle. Il est temps de stopper notre progression pour retrouver le Lac de la Muzelle. Il reste encore la montée vers le Col du Vallon à effectuer avant la tombée de la nuit.

Sur le fil de l’arête, en direction des Deux Alpes.


Avant les arches, on repasse près de ce cairn dont les abords accueillent quelques brins de Génépi. Mais pas touche ! C’est le Parc National ici !

Le sentier descend progressivement vers le Refuge de la Muzelle. C’est dans les pitons rocheux au-dessus du refuge que se cachent les deux arches.

Pour celle-ci, c’est carrément le sentier qui y passe à travers. C’est la fameuse Roche Percée indiquée par les panneaux du refuge.

L’arche et la Roche de la Muzelle.

On retrouve le Refuge de la Muzelle. Pour les chanceux qui y dormiront, c’est déjà l’heure du diner. Quant à nous, on poursuit sur les bords du lac avant de partir sur la droite, laissant le sentier montant vers le Col de la Muzelle.

Pour donner une idée du crochet vers le Glacier de la Muzelle, nous avons atteint la crête rocheuse pile au centre de la photo.
Passer le col du Vallon
C’est 400m de dénivelés positifs qu’il reste à effectuer entre le Lac de la Muzelle et le Col du Vallon. Dans un premier temps, on traverse un éboulis de gros blocs avant d’atteindre les gradins herbeux où un défilé de lacets nous attend pour finalement déboucher au col. Les marmottes nous accompagnent durant l’ascension.


Un orage inattendu semble se former sur le Sud du Massif des Ecrins. La présence de réseau permet de confirmer l’instabilité sur les Hautes-Alpes mais elle est en voie de dissipation.

Aux quelques cris des marmottes du coin, il ne faut pas hésiter à lever les yeux vers le ciel. Ce n’est pas moins d’une dizaine de vautours fauves qui se sont envolés de la paroi de la Tête de la Muraillette à la recherche de leur diner. On les devine dans le ciel lugubre surplombant les Ecrins.

Une fois au Col du Vallon 2540m, notre regard plonge vers la Vallée de la Romanche et le Bourg d’Oisans. La vallée est striée par les rayons du soleil s’affaissant peu à peu.
L’orage des Hautes-Alpes a créé une enclume gigantesque au-dessus du Massif des Ecrins. Une enclume est le nom donné à la partie la plus haute d’une cumulonimbus s’étalant dans l’atmosphère. Bien que l’orage frappe à un endroit, elle et son ombre peuvent l’étaler sur des superficies bien plus larges. Celle-ci a recouvert une bonne partie du Sud-Est de l’Isère. En descendant vers l’horizon, le soleil devrait donc refaire une apparition sous peu.

Depuis le Col du Vallon on aperçoit que trop peu la Roche de la Muzelle. En arpentant sur quelques dizaines de mètres le sentier qui suit les arêtes et mène à l’Aiguille de Vénosc, on peut bénéficier d’une plus ample vue sur le sommet comme on peut le voir sur cette photo. En attendant que le soleil réapparaisse, le diner est servi !

Il n’aura pas fallu attendre très longtemps avant que les rayons illuminent la face Ouest de l’Aiguille de Vénosc. Planter la tente attendra, place à l’appareil photo !

Petit à petit, le soleil se dégage de l’ombre de l’enclume. A l’inverse d’un lever du soleil, l’illumination commence par le bas.

La Tête de la Muraillette et son ombre sur la face Ouest de la Roche de la Muzelle. Le reste des Ecrins attend patiemment les premiers rayons.

Le Lac de la Muzelle n’aura malheureusement pas eu le droit à quelques lueurs.

Alors que les Aiguilles d’Arves (à gauche) et la Barre des Ecrins (à droite) sont dans l’obscurité, les montagnes entourant le Vallon du Diable au centre profitent des rayons.

Un peu plus tard, la Barre des Ecrins est baignée par la luminosité.


L’Aiguille du Plat de la Selle a quelques minutes d’intervalle.
Quelques clichés de la luminosité sur la Roche de la Muzelle et son glacier :



Quelques clichés de la luminosité sur la Tête de la Muraillette :



Le Glacier du Peyron est dans un état moribond. Même les cartes IGN, pourtant assez conciliantes avec l’état des glaciers alpins, indiquent »ancien Glacier du Peyron ».

Puis le soleil finit par se cacher derrière la Pointe de Malhaubert. On aperçoit bien l’enclume de l’orage hautalpin encore présente dans le ciel isérois.


Ambiance caniculaire sur la Chaine de Belledonne.
Il est temps de monter la tente dans un creux sous le Col du Vallon, une petite source permet le ravitaillement en eau. Un avantage avant une nuit en bivouac et une ascension à l’aube. Mais un événement vient rapidement interrompre l’installation du bivouac.
Les rayons du soleil, après avoir fuit les cimes, s’engouffrent sous les nuages de l’enclume. C’est un festival céleste qui apparait peu à peu au-dessus de l’Ouest des Ecrins et de Belledonne.

En zoomant un peu plus sur le trio d’en face : la Pointe de Confolens, la Pointe de Malhaubert et le Rochail.

Ce spectacle inattendu se poursuit quelques minutes encore puis s’estompe pour laisser place à un ciel étoilé légèrement voilé. Il faut retourner au bivouac afin de finir son installation, à la frontale cette fois-ci.

Au-dessus de l’arête menant à la Tête de la Muraillette.
En direction de Belledonne et de la Vallée de la Romanche.

Quelques minutes plus tard, le Rivier d’Allemont et l’Alpe d’Huez s’illuminent à leur tour.


Paré pour une petite nuit à la »fraîche ». A 2500m et avec une polaire, on a encore chaud…


Sous les restes du Glacier du Peyron, de nombreux éboulis se produisent. Une fois dans la tente, leur fracas peut surprendre mais pas de danger au niveau du bivouac, les rochers partent dans la pente de l’autre côté du Col du Vallon.
4h40, c’est l’heure du réveil. En s’étant coucher à 23h à cause de la beauté du ciel au-dessus des Ecrins, se lever est un peu rude. Rarement une nuit de bivouac n’a été aussi chaude : pas besoin de chaussettes, pas besoin de collants, pas besoin de polaire ni d’enfiler le sac de couchage jusqu’aux bras. Même à 5h du matin, sortir de la tente n’est pas difficile tant l’atmosphère à 2500m est tempérée.
Après avoir remballé la tente, l’Est commence déjà à se parer de couleurs chaudes, signes que le soleil commence son inexorable ascension. Pour nous aussi, c’est le début de l’ascension, à la frontale. Depuis le Col du Vallon, il faut suivre une légère sente vers le Sud puis, une fois dans le pierrier, il suffit de suivre les nombreux cairns présents dans la pente et qui nous conduisent jusqu’à l’arête de la Tête de la Muraillette. Aucune difficulté à prévoir.

Des Aiguilles d’Arves à la Barre des Ecrins, les cimes se décalquent parfaitement dans le ciel.



Pic du Mas de la Grave / Aiguilles d’Arves et Aiguille du Goléon / Aiguille de Vénosc. Tous attendent les premiers rayons.


Alors que le soleil menace de frapper les Aiguilles d’Arves d’une minute à l’autre, la Lune et l’obscurité dominent la Tête de la Muraillette.

Dentelle des Ecrins. Entre le Dôme de la Lauze et la Barre.

Tranquillement, on atteint l’arête de la Tête de la Muraillette. D’autres montagnes émergent : le Dévoluy dans le creux à gauche, suivi du Signal du Lauvitel, du Grand Armet dans le Massif du Taillefer et de la Pointe de Malhaubert.


Le Pic du Clapier du Peyron et son petit Glacier des Pisses / Le Lauvitel.
De l’autre côté de l’arête, on surplombe la Réserve Intégrale du Lauvitel. Il s’agit de la zone du Parc National des Ecrins la plus réglementée. Son accès est strictement interdit et aucun sentier de randonnée et voie d’alpinisme ne la traversent.
Il y a même des capteurs de mouvements, non seulement pour suivre les migrations des espèces sauvages mais également pour arrêter les contrevenants. Seuls quelques scientifiques et personnels du parc ont pu fouler la partie située au bord du rivage Sud du Lauvitel depuis 1995, date de sa création. Son but ? Voir le fonctionnement et les évolutions de la nature sans interférences humaines. Située entre 1500 et 3000m d’altitude, cette réserve permet une approche globale de l’espace montagnard.
Pour l’anecdote, 1922 marque la date du dernier arbre coupé sur cette zone et c’est dans les années 1950 que les derniers troupeaux paissent sur ces pentes. En 1975, ce territoire de 700 hectares est cédé à l’Etat puis c’est autour du concept de »libre évolution » que la réserve est née au milieu des années 1990. Au-delà de l’étude de la biodiversité et des recherches archéologiques (des alpages sans pâturages, un enneigement sans damage, une forêt sans coupe), le changement climatique est au coeur des études scientifiques concernant cette zone qui représente parfaitement les Alpes du Nord sur une toute petite échelle.
Ainsi les deux bords du Lauvitel sont l’objet de tous les extrêmes : aucune interférence humaine côté Sud alors que le rivage Nord est l’un des lieux les plus touristiques du Parc National des Ecrins. En France, seule la Réserve intégrale marine de Port-Cros met en place une telle réglementation.
Pour la toponymie, on dit Lauvitel et non Lac Lauvitel ou Lac du Lauvitel car »Lau » signifie »Lac » et »Vitel » signifie »Eau ». Ainsi, pour éviter la tautologie revenant à dire »Lac Lac », il est préférable de n’utiliser que »Lauvitel » pour désigner ce lac.

C’est fait ! Les premiers rayons illuminent les crêtes du Nord-Ouest des Ecrins. Plus que quelques secondes avant notre tour.


Alors que l’Obiou et le Grand Ferrand se parent de rouge pâle, le Glacier de la Girose nous laisse enfin entrevoir les premières lueurs.

L’arête se rétrécit un peu mais rien de bien vertigineux. Les blocs sont stables.

Timide rayon sommital sur le Pic du Clapier du Peyron.

Seuls le fond de la Vallée de la Romanche ainsi que le Col du Vallon restent dans l’obscurité.

Sommet en vue !


Prolongement de l’arête vers la Pointe de Malhaubert / Les Grandes-Rousses prolongent l’Aiguille de Vénosc.

Le sommet de la Tête de la Muraillette 3019m est atteint à 6h34. Le panorama s’ouvre à 360°. Les principaux absents sont les deux lacs du parcours : le Lac de la Muzelle et le Lauvitel.

Les rayons transperçant les vallées des Ecrins : à gauche la Meije prend la forme du Râteau. Au centre, la Grande Ruine se dresse à côté de l’Aiguille du Plat de la Selle.


Le Pic du Clapier du Peyron 3169m / L’Aiguille de Vénosc 2830m

Le cairn sommital et le panorama vers l’Ouest. Même quelques sommets du Vercors et de la Chartreuse sont visibles à travers le voile d’une journée qui s’annonce une nouvelle fois caniculaire.
Du sommet, on entend par moment des rochers qui dégringolent. En y regardant de plus près, il s’agissait en réalité de quelques bouquetins défiant la gravité dans la paroi Nord. Trop loin pour les photographier malheureusement, il n’avait que faire de cet individu tout ébouriffé au sommet de la Tête de la Muraillette.
Le petit vent frais du sommet dissuade de sortir le petit déjeuner. Quelques instants au sommet pour profiter du panorama puis c’est parti pour la longue et rude descente vers le Lauvitel, 1500m plus bas. Pour cela, on reprend le même itinéraire jusqu’au Col du Vallon avant de basculer du côté Ouest de l’Aiguille de Vénosc, à l’ombre fort heureusement.

Les dalles rocheuses permettant l’accès à l’arête de la Tête de la Muraillette. La Lune est encore parmi nous.

Dernier regard en direction du Vallon du Diable et de la Meije depuis le Col du Vallon.

Mi ombre, mi soleil sur le lieu du bivouac. On part à l’ombre maintenant. Encore 1000m de dénivelés négatifs avant le Lauvitel.

Les grosses marmottes du Lauvitel. Au niveau du lac et du fait de leur caractère peu farouche, des panneaux indiquant l’interdiction de les nourrir ont été installés par le Parc National.

La Vallée de la Romanche retrouve enfin sa luminosité. Dans la journée, il est fort probable qu’elle aurait préféré rester dans l’ombre de la montagne.

Quelques vagues silhouettes s’aperçoivent par moment sur la face Ouest de l’Aiguille de Vénosc. Ici, probablement un chamois.

Puis après quelques dizaines de zigzags dans les pentes abruptes de l’Aiguille de Vénosc, le rivage Ouest du Lauvitel apparait au fond du vallon. A en voir le reflet des parois chutant dans ses eaux, le vent est faible ce matin-là sur le plus grand lac du Massif des Ecrins.



1500m de chute séparent la surface du Lauvitel du sommet de la Pointe de Malhaubert 3049m.

200m au-dessus du lac, le sentier devient légèrement plus vertigineux en traversant un couloir d’avalanche. Le sentier a été refait l’année dernière par les agents du Parc National des Ecrins avec quelques câbles et quelques escaliers. Ce parcours étant particulièrement foulé puisque faisant partie du GR54 : le Grand Tour de l’Oisans et des Ecrins.


On fait face à la Réserve intégrale.
Notre itinéraire de la Tête de la Muraillette : lac Lauvitel
Sur les bords du Lauvitel 1510m, c’est enfin l’heure du petit déjeuner. Les quelques lève-tôt et les quelques randonneurs ayant bivouaqué près du lac n’hésitent pas se baigner dans ses eaux translucides. L’eau y est particulièrement bonne, la faible altitude et les fortes chaleurs estivales ayant aidé. En tout cas, elle l’est en surface car le Lauvitel peut atteindre une profondeur de 68m !

La chaleur est déjà présente et cela ne va faire qu’empirer. Il ne reste plus que 600m de dénivelés négatifs pour atteindre le fond de vallée. Heureusement, il s’agit majoritairement d’un sentier en sous bois où coulent de nombreux ruisseaux. Deux sentiers mènent au départ du Lauvitel, les deux partant à la parallèle de chaque côté du vallon. Qu’importe celui que vous choisissez.
Une fois au départ du Lauvitel, au petit hameau de La Danchère, la voiture n’est pas encore atteinte. Il faut maintenant relier le hameau du L’Alleau, près de Vénosc. Pour se faire, un sentier balisé remonte le Vénéon en longeant le pied de l’Aiguille de Vénosc. Vers la mi-chemin, le sentier est malheureusement fermé à cause d’éboulements. Il faut donc traverser le Vénéon et emprunter la voie verte jusqu’à la voiture. Ou alors vous pouvez faire du stop !




Bouclons la boucle
La couleur du Vénéon adoucit cette lente traversée vers la voiture. Sa couleur tient du fait qu’il est alimenté par des dizaines de glaciers du coeur du Massif des Ecrins. Au fond de la Vallée, il se jettera dans la Romanche.
Vers 12h30, la boucle est bouclée, plus de 24km de randonnée et 2700m de dénivelés positifs et négatifs avalés en quasiment 24h puisque la veille, le départ s’est effectué vers 13h30. La particularité de ce tour est que le gros du dénivelé positif est réalisé le premier jour avec plus de 2000m d’ascension et le gros du dénivelé négatif est réalisé quant à lui la seconde journée, avec là aussi plus de 2000m de descente. Ce tour peut être raccourci en évitant les arches de la Muzelle ou l’ascension du sommet. Il peut être également allongé en y rajoutant la traversée des arêtes de l’Aiguille de Vénosc ou l’ascension du Col de la Muzelle. Bref, les choix sont nombreux pour partir à la rencontre de deux des plus beaux lacs du département de l’Isère.
En vallée, la chaleur est écrasante. Et cela ne donne pas envie de traverser la métropole grenobloise. On y regrette vite le petit vent frais à 3000m d’altitude. Les 40°C seront de nouveau frôlés ce jour-là en Isère. Même les quelques orages prévus en fin de journée près des reliefs n’y changeront rien. S’hydrater et suer, tel est notre quotidien pour la semaine à venir.
Tête de la Muraillette, l’itinéraire de la randonnée :